
Les
premiers
calendriers
apparurent,
probablement,
il
y
a
cinq
mille
ans
lorsque
les
hommes
s'aperçurent
que les astres, qu'ils observaient avec une certaine appréhension, se déplaçaient selon des cycles réguliers.
Lentement,
des
systèmes
permettant
de
diviser
le
temps
furent
élaborés
et
on
repéra
plus
facilement
la
période de l'année la plus propice aux semailles.
Comme
de
cette
découverte
découla
une
amélioration
de
la
production
agricole,
almanachs
et
calendriers
devinrent bien vite des instruments de la plus haute importance.
La
notion
d'année
est
née
de
l'observation
des
saisons
qui
règlent
la
vie
animale
et
végétale
et,
par
conséquent,
les
activités
agricoles,
essentielles
pour
se
nourrir
et
survivre
depuis
les
temps
les
plus
reculés
de
la préhistoire.
Le premier calendrier "solaire".
Ce
furent
les
Égyptiens
qui
découvrirent
que
la
succession
des
saisons
(c'est-à-dire
le
temps
d'une
révolution
de
la
Terre
autour du Soleil) durait environ 365 jours.
Ils utilisèrent donc un calendrier comportant 12 mois de 30 jours, plus 5 jours complémentaires.
Mais, tous les 4 ans, 1 jour était perdu et avec le temps, les fêtes d'automne tombèrent en été...
À l'origine, le calendrier romain est composé de 10 mois, totalisant 304 jours.
Les 61 jours d'hiver ne font alors partie d'aucun mois.
Vers
713
av.
J.-C.,
le
roi
légendaire
Numa
Pompilius
(21
avril
753
–
673
av.
J.C.)
aurait
ajouté
les
mois
de
janvier
et
février,
étendant
l'année
à
365
jours,
adoptant
comme
beaucoup
d'autres
peuples
le
calendrier
Egyptien.
Pour passer de l'ancien système au nouveau, il y eut une année de transition ... de 445 jours afin de réaligner une bonne fois le début de l'année sur l'équinoxe de printemps. ...
Elle fut appelée, à juste titre, ''l'Année de la Confusion".
En
46
avant
J.C.,
Jules
César
(juillet
100
Av
J.C./
15
mars
44),
sur
le
conseil
de
l'astronome
grec
Sosigène,
décide
de
remplacer
le
calendrier
lunaire
jusque-là
en
vigueur
par
un
calendrier
solaire,
dit
"julien"
(du
nom
de l'empereur).
L'année
"julienne"
durait,
en
moyenne,
365
jours
'
et
6
heures
alors
que
l'année
"solaire"
ne
dure
que
365
jours, 5 heures, 48 minutes et 46 secondes...
Il y avait donc une différence de 11 minutes et, au bout de 128 ans, cela représentait un jour entier... !
Seule
différence
:
le
premier
jour
de
l'année
est
fixé
au
1er
mars,
mois
très
important
à
Rome,
car
associé
au
dieu de la guerre.
Cette répartition a laissé des traces aujourd'hui.
Nos
derniers
mois
de
l'année
actuels
s'appellent
ainsi
octobre
(de
"octo",
le
huitième),
novembre
(de
"novo"
le
neuvième)
et
décembre
(de
"decem"
le
dixième)
alors
qu'ils
sont
désormais
les
dixième,
onzième
et
douzième mois de l'année.
En
532,
l'Église
décide
de
faire
commencer
l'année
au
1er
janvier,
mois
qui
suit
immédiatement
la
naissance
du
Christ,
fixée
au
25
décembre
753
de
l'an
de
Rome
(la
fondation
de
la
ville
éternelle
servant
de
point
de
départ au calendrier romain) par le Pape Libère (xxxx – 24 septembre 366).
Pour autant, le 1er janvier n'est pas le premier jour de l'année pour tous.
Dans
certaines
régions
de
France,
c'est
Pâques,
date
anniversaire
de
la
résurrection
du
Christ,
qui
fait
office
de
Nouvel An.
Mais cela pose quelques problèmes.
Pâques est une date mobile qui correspond au premier dimanche après la pleine lune de printemps (21 mars).
On
peut
donc
se
retrouver
aussi
bien
avec
des
années
de
longueur
variable,
ce
qui
s'avère
bien
compliqué
à
l'usage.
Dans
d'autres
pays
ou
régions,
c'est
Noël
qui
est
choisi
comme
début
de
l'année
:
ainsi,
à
Lyon,
dans
le
Poitou,
en Normandie ou en Anjou...
En
1582,
lorsque
l'avance
du
calendrier
sur
l'année
solaire
eut
atteint
10
jours,
le
pape
Grégoire
XIII,
suivant
le
conseil
de
l'astronome
allemand
Christoph
Klau
(1538-1612),
réforma
le
calendrier
julien
et
imposa
le
calendrier
grégorien
du
nom du pape Grégoire XIII (1502-1585 - pape de 1572 à 1585).
La structure du calendrier grégorien est analogue à celle du calendrier julien.
Le calendrier grégorien donne un temps moyen de l'an de 365,2425 jours.
Le calendrier julien n'était en effet pas en accord avec l'année solaire, car il avançait d'environ 11 minutes.
C'est pour rétablir ce décalage que la réforme du Pape est entrée en vigueur.
Pour
assurer
un
nombre
entier
de
jours
par
année
et
pour
correspondre
à
la
réalité
solaire,
on
y
ajoute
régulièrement
(tous les 4 ans en principe) un jour bissextile, le 29 février.
L'année 1582 compte dix jours de moins pour rattraper le décalage avec le soleil.
Quand
les
catholiques
européens
se
réveillent
le
lendemain
du
jeudi
4
octobre,
ils
sont
en
réalité
le
vendredi
15
octobre
selon le nouveau calendrier.
Certains en voulurent beaucoup au Pape en l'accusant de leur avoir volé 10 jours de leur vie ...
On
choisit
les
années
divisibles
par
4,
sauf
celles
divisibles
par
100,
sans
l'être
par
400
(ainsi
1900
n'était
pas
bissextile,
car divisible que par 100 et pas par 400... par contre, 2000 sera bissextile, car divisible par 100 et 400).
On pensait être à l'abri des caprices du Temps ...
En
réalité,
l'année
Grégorienne
est
encore
trop
longue
de
0,0003
jour
...
dans
10
000
ans,
notre
calendrier
comportera
3
jours
de
trop
...
mais
nous
ne
serons
plus
là
pour
nous
en plaindre ... !
Le
calendrier
grégorien
remporta
un
vif
succès
et
l'Espagne
appliqua
aussitôt
la
réforme
et
Ste-Thérèse
d'Avila
(1515
-1532)
qui
mourut
le
4
octobre
1582,
fut
enterrée
le
lendemain, 15 octobre ...
Tous les pays d'Europe suivirent l'exemple de l'Espagne sauf l'Angleterre qui attendit 1751 pour se décider ...
En revanche, pas de modification de la date du Nouvel An.
C'est ce calendrier qui est toujours en vigueur aujourd'hui.
Si
le
calendrier
grégorien
est
d'usage
international,
certains
pays
utilisent
encore
des
calendriers
fondés
sur
une conception du Temps, propre à leur civilisation.
1 er janvier 2000 ou 24 ramadan 1420 ou 23 tébeth 5760 ?
Pour
les
Musulmans,
ce
sera
le
24
ramadan
1420,
car
ils
comptent
les
années
à
partir
de
l'"Hégire",
"la
fuite"
du prophète Mahomet de la Mecque vers Médine le 16 juillet 622 (par rapport au calendrier grégorien).
De
plus,
leur
calendrier
est
"lunaire"
:
les
mois
correspondent
approximativement
à
l'intervalle
entre
deux
nouvelles lunes.
Quant aux Israélites, leur calendrier indiquera le 23 tébeth 5760.
En effet, son point de départ est fixé au 7 octobre 3760 av. J.-C. (toujours par rapport au calendrier grégorien), date très précise (!) de la Création du Monde ...
Si les mois sont lunaires, l'année suit le cycle solaire grâce à un système complexe d'années comptant parfois 13 mois ...
Dans notre inventaire, nous ne pouvons pas oublier, un calendrier qui, bien qu'éphémère, a marqué notre Histoire.
Ce fut le calendrier révolutionnaire.
En effet, il n'eut cours que du 5 octobre 1793 au 31 décembre 1805...
Ce
fut
Philippe
Fabre
d'Eglantine,
l'auteur
de
"il
pleut,
il
pleut,
Bergère
...
"
qui
élabora
ce
calendrier
républicain.
Il divisait l'année de 365 jours en 12 mois, eux-mêmes divisés en 3 décades de 10 jours.
Pour parvenir aux 365 jours, on ajoutait 5 jours "complémentaires" : les "Sans-Culottides".
Ces
jours
étaient
destinés
à
célébrer
des
fêtes
républicaines
:
celles
de
la
Vertu,
du
Génie,
du
Travail,
de
l'Opinion, des Récompenses.
Le
point
de
départ
était
fixé
au
22
septembre
1792,
date
de
la
proclamation
de
la
1ère
République
(et
par
pure coïncidence, de la victoire de Valmy).
Les
noms
des
mois
d'une
même
saison
se
terminaient
par
un
même
suffixe
:
"aire"
pour
l'automne,
"ôse"
pour l'hiver, "al" pour le printemps, "or" pour l'été.
Comme
beaucoup
de
révolutionnaires,
Fabre
d'Eglantine,
doux
poète,
coureur
de
jupons,
mais
aussi
sanguinaire
Commissaire
de
la
République,
fut
décapité
en
compagnie
de
son
ami
Danton
le
15
Prairial
An
II,
le
jour
des
Abeilles,
ce
qui
est
plus
poétique,
avouez-le,
que
le
5
Avril 1794...
Mais que représente le calendrier grégorien :
Janvier
du
latin,
"ianuarius"
ou
"januarius",
nommé
en
l'honneur
de
"Janus",
dieu
romain
des
commencements et des fins, des choix, des clés et des portes..
Février du latin, "februarius", lui-même dérivé du verbe "februare" signifiant "purifier".
Mars du latin "Martius", donné à ce mois par les Romains en l'honneur du dieu "Mars", dieu de la guerre.
Avril
du
latin
"Aprilis",
de
l'étrusque
"Apru",
donné
par
les
romains
en
l'honneur
de
la
déesse
"Aphrodite",
déesse de la beauté et de l'amour.
Mai du latin "maius", en référence à la divinité italique "Maia" déesse romaine de la fertilité et du printemps.
Juin du latin "junius" donné en l'honneur de la déesse romaine "Junon".
Juillet du latin "julius" en l'honneur de Jules César.
Août du latin "augustus", nom donné en l'honneur de l'empereur romain Auguste en 8 av. J.C..
Septembre du latin "september", septième mois de l'ancien calendrier romain.
Octobre du latin "october" car il était le huitième mois de l'ancien calendrier romain.
Novembre du latin "november" (de novem, neuf) car il était le neuvième mois de l'ancien calendrier romain.
Décembre du latin "december" (de decem, dix) car il était le dixième mois de l'ancien calendrier romain.




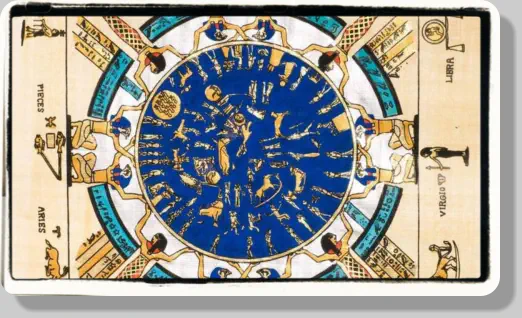
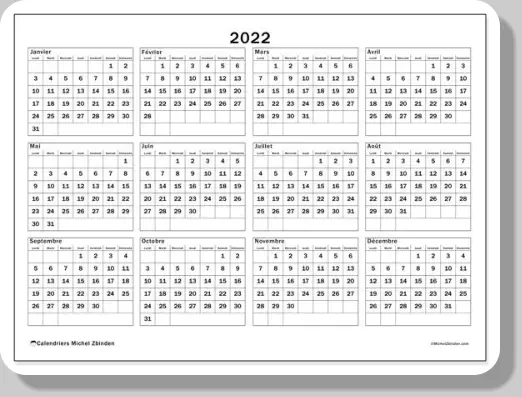
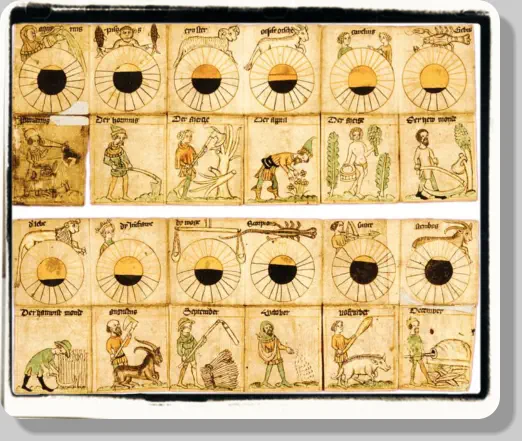
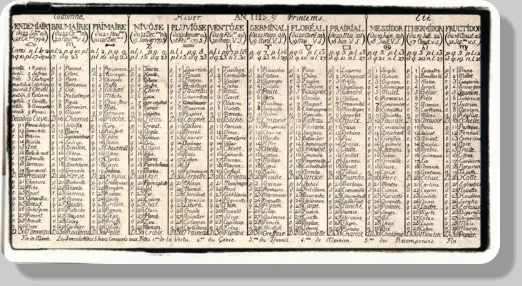
L'importance du calendrier dans l'histoire
Le
calendrier
est
un
outil
fondamental
pour
l'organisation
de
la
vie
humaine,
structurant
le
temps,
planifiant
les
activités
et
fixant
les
dates
des
événements
importants.
Son histoire est riche en réformes et modifications visant à améliorer la précision et l'efficacité de la mesure du temps.
Le calendrier romain et ses limites
Dans le contexte de l'histoire occidentale, le calendrier romain était largement utilisé jusqu'au début du Moyen Âge.
Le calendrier julien, mis en place par Jules César en 45 av. J.-C., était le système de datation dominant dans l'Empire romain.
Ce calendrier organisait l'année en 12 mois, avec des ajustements périodiques pour tenir compte des cycles solaires.
Les mois avaient des durées variables, et un mois intercalaire était parfois ajouté pour synchroniser le calendrier avec les saisons.
Cependant, ce calendrier présentait des imprécisions, notamment concernant la durée de l'année et la date de l'équinoxe vernal.
L'année julienne était légèrement plus longue que l'année solaire réelle, ce qui entraînait un décalage progressif au fil des siècles.
Pour la datation, les Romains utilisaient le système ab urbe condita (AUC), qui comptait les années depuis la fondation de Rome (753 avant JC).
Des systèmes basés sur les règnes des empereurs romains ou sur des événements importants étaient également employés.
La complexité du système romain et son imprécision croissante ont conduit à la recherche de solutions plus précises et fiables.
Denys le Petit et la naissance de l'Anno Domini
Au
VIe
siècle
après
J.-C.,
l'Église
chrétienne
avait
besoin
d'un
calendrier
plus
précis
pour
célébrer
et
synchroniser
les
fêtes
religieuses
et
principalement
Pâques, dont la date était déterminée par le cycle lunaire et l'équinoxe de printemps.
C'est dans ce contexte que Denys le Petit, un moine chrétien du VIe siècle, a entrepris de calculer la date de la naissance de Jésus.
Il était un érudit respecté, connu pour son travail sur les textes bibliques et les canons de l'Église.
On lui a confié la tâche de réviser le comput pascal, le système utilisé pour calculer la date de Pâques.
Denys
le
Petit
s'est
appuyé
sur
des
sources
variées,
notamment
les
écrits
des
Évangiles,
les
chroniques
romaines
et
les
écrits
des
historiens
chrétiens
et
a
déterminé
que
Jésus
était
né
en
l'an
753
de
la
fondation
de
Rome,
ce
qui
correspondait
à
l'an
1
après
J.-C.
dans
son
nouveau
système
de
datation
(calendrier
Dionysien).
Cependant, la fiabilité de ces sources est contestée par les historiens.
La date de naissance de Jésus est incertaine et l'on estime que Denys le Petit a pu se tromper de plusieurs années.
L'intention
de
Denys
n'était
pas
de
créer
un
nouveau
calendrier,
mais
de
remplacer
le
système
de
datation
existant,
qui
était
basé
sur
le
règne
de
l'empereur
Dioclétien, un persécuteur des chrétiens.
L'adoption et l'influence de l'Anno Domini
Le calendrier julien modifié par Denys le Petit, incluant l'Anno Domini, a rapidement gagné en popularité dans le monde chrétien.
Il a été adopté par les monastères, les écoles et les communautés religieuses, et est devenu un système de datation standardisé en Europe.
Son adoption a facilité la communication et la coordination entre les différentes régions et institutions chrétiennes.
Le
système
de
datation
Anno
Domini
(AD),
qui
signifie
"l'année
du
Seigneur"
en
latin,
est
un
système
de
chronologie
largement
utilisé
dans
le
monde
occidental.
Il établit un point de référence pour le calcul des années, marquant le début de l'ère chrétienne avec la naissance de Jésus de Nazareth.
L'AD
a
joué
un
rôle
crucial
dans
la
façon
dont
nous
comprenons
et
organisons
l'histoire,
influençant
la
perception
du
temps
et
l'écriture
de
l'histoire
elle-
même.
Il a permis de créer une chronologie cohérente et partagée, facilitant l'étude et la compréhension des événements passés.
L'influence du calendrier Dionysien s'étend bien au-delà du domaine religieux, affectant la culture, la science et la vie quotidienne.
Débats et critiques autour de l'Anno Domini
Malgré la diffusion de l'Anno Domini, certains débats ont persisté sur sa précision et sur la nécessité de proposer des alternatives.
Certains historiens ont contesté le calcul de Denys, tandis que d'autres ont proposé des méthodes de datation différentes.
Ces débats reflètent les complexités et les incertitudes inhérentes à la reconstruction du passé.
La remise en question des sources et des méthodes de datation est essentielle pour une compréhension critique de l'histoire.
L'un des principaux arguments contre l'Anno Domini était l'incertitude concernant la date exacte de la naissance de Jésus-Christ.
Les historiens et les théologiens ont proposé différentes dates, ce qui a remis en question la précision de l'ère chrétienne.
Il existe également des critiques sur l'utilisation de la naissance de Jésus-Christ comme point de départ de l'histoire humaine.
Malgré
ces
débats,
l'Anno
Domini
est
resté
la
méthode
de
datation
dominante
dans
l'Europe
occidentale,
et
son
influence
sur
la
chronologie
et
la
compréhension de l'histoire a été considérable.
Bède le Vénérable et le calcul du temps
Au
VIIIème
siècle,
Bède
le
Vénérable,
un
moine
anglais,
l'un
des
plus
grands
érudits
du
Haut
Moyen
Âge,
était
connu
pour
ses
connaissances
encyclopédiques
dans les domaines de la théologie, de l'histoire, de la littérature et de la science.
Il a contribué de manière significative à l'avancement des connaissances et à la diffusion de l'éducation.
Ses travaux ont eu une influence durable sur la pensée et la culture médiévales.
L'influence de Bède sur le calcul du temps a été considérable.
Il
a
proposé
des
méthodes
de
calcul
des
dates
de
Pâques,
des
fêtes
religieuses
et
des
événements
historiques,
basées
sur
les
connaissances
astronomiques
et
les
cycles lunisolaires.
Bède a été l'un des premiers à utiliser des méthodes scientifiques pour calculer le temps.
Il a étudié les mouvements des astres et les cycles lunisolaires pour déterminer les dates des événements religieux et astronomiques.
Son travail a contribué à la précision du calcul du temps et à une meilleure compréhension du cosmos.
Ses écrits ont été largement diffusés et ont influencé les moines, les savants et les érudits du Haut Moyen Âge.
Il a également popularisé l'utilisation du système Anno Domini pour la datation des événements historiques.
Le décalage du calendrier julien
Cependant, des erreurs dans le calcul de l'année tropicale ont conduit à un décalage progressif entre le calendrier julien et la réalité astronomique.
L'année julienne était légèrement plus longue que l'année solaire réelle, ce qui entraînait une accumulation d'environ 11 minutes par an.
Au fil des siècles, ce décalage s'est amplifié, entraînant une désynchronisation progressive du calendrier avec les saisons et les événements astronomiques.
Au
XVIe
siècle,
ce
décalage
a
atteint
approximativement
10
jours,
ce
qui
a
posé
des
problèmes
pour
la
détermination
des
dates
des
fêtes
religieuses
et
des
saisons.
Ce décalage affectait notamment la date de l'équinoxe vernal, qui est cruciale pour le calcul de la date de Pâques.
La nécessité de corriger ce décalage est devenue de plus en plus urgente, conduisant à la réforme du calendrier.
La réforme grégorienne et son adoption
Le pape Grégoire XIII a donc décidé de réformer le calendrier julien en introduisant le calendrier grégorien.
Il a nommé une commission d'experts, composée d'astronomes, de mathématiciens et de théologiens, pour étudier la question et proposer une solution.
La commission a recommandé de supprimer 10 jours du calendrier et de modifier la règle des années bissextiles.
La réforme grégorienne a consisté à supprimer 10 jours du calendrier julien et à modifier la règle de l'année bissextile pour corriger le décalage accumulé.
L'Église
catholique
voulait
harmoniser
les
dates
des
fêtes
religieuses
avec
la
réalité
astronomique,
tandis
que
les
scientifiques
cherchaient
à
améliorer
la
précision du calcul du temps.
L'adoption
du
calendrier
grégorien
a
été
un
processus
complexe,
mais
elle
a
contribué
à
une
plus
grande
précision
dans
la
mesure
du
temps
et
à
une
meilleure
coordination des activités humaines.
Certains pays ont adopté la réforme rapidement, tandis que d'autres ont résisté pendant des siècles.
L'adoption du calendrier grégorien a également eu des implications politiques, économiques et sociales.
Le calendrier grégorien aujourd'hui et les alternatives
Le calendrier grégorien est plus précis que le calendrier julien et est utilisé aujourd'hui par la plupart des pays du monde.
Il est considéré comme un standard international pour la datation des événements et la planification des activités.
Cependant, certains pays et cultures continuent d'utiliser des calendriers traditionnels ou des adaptations du calendrier julien.
Bien que le calendrier grégorien soit largement utilisé, il existe des alternatives dans différentes cultures.
Ces alternatives reflètent la diversité des traditions et des croyances à travers le monde.
Les calendriers traditionnels peuvent avoir une signification culturelle, religieuse ou historique importante.
Ils peuvent être utilisés pour la célébration des fêtes, la planification des activités agricoles ou la détermination des dates des événements familiaux.
Diversité des calendriers culturels
Les systèmes de calendriers varient considérablement à travers le monde, reflétant les différentes cultures et traditions.
Chaque
calendrier
est
basé
sur
des
observations
astronomiques
et
des
calculs
mathématiques,
mais
ils
diffèrent
dans
leurs
points
de
référence
et
leurs
méthodes de calcul.
Par
exemple,
les
calendriers
hébreu,
islamique
et
bouddhiste
utilisent
des
systèmes
de
datation
différents
basés
sur
des
points
de
référence
religieux
ou
historiques propres à chaque culture.
L'héritage de Denys le Petit et Bède le Vénérable
Denys le Petit (470 – 537/555) et Bède le Vénérable (672-735) ont contribué de manière essentielle à l'évolution de la mesure du temps.
Leurs travaux ont marqué un tournant dans la chronologie et ont influencé la façon dont nous comprenons l'histoire aujourd'hui.
Ils ont apporté des contributions significatives à la science, à la théologie et à la culture de leur époque.
Leur héritage continue d'inspirer les chercheurs et les érudits d'aujourd'hui.
L'introduction
de
l'Anno
Domini,
la
réforme
du
comput
pascal
et
les
contributions
de
Bède
au
calcul
du
temps
ont
joué
un
rôle
majeur
dans
l'harmonisation
des dates, la coordination des activités humaines et la diffusion d'une vision unifiée de l'histoire.
Leurs travaux ont permis de créer une chronologie cohérente et partagée, facilitant l'étude et la compréhension des événements passés.
Ils
ont
également
contribué
à
la
précision
du
calcul
du
temps,
ce
qui
a
eu
des
implications
pratiques
pour
la
navigation,
l'agriculture
et
d'autres
domaines
de
la
vie humaine.
Conclusion
Leur
héritage
continue
d'influencer
notre
vie
quotidienne,
et
leurs
contributions
à
la
mesure
du
temps
restent
un
témoignage
de
l'ingéniosité
et
de
la
perspicacité des érudits du Moyen Âge.
Sans leurs efforts, notre compréhension du temps et de l'histoire serait considérablement différente.
L'évolution du calendrier témoigne de la quête incessante de l'humanité pour comprendre et maîtriser le temps.
L'étude du calendrier à travers l'histoire révèle les liens étroits entre la science, la religion et la culture.
Les réformes et les adaptations du calendrier reflètent les changements sociaux, politiques et intellectuels qui ont façonné notre monde.
Le calendrier n'est pas seulement un outil de mesure du temps, mais aussi un reflet de notre histoire et de notre identité culturelle.